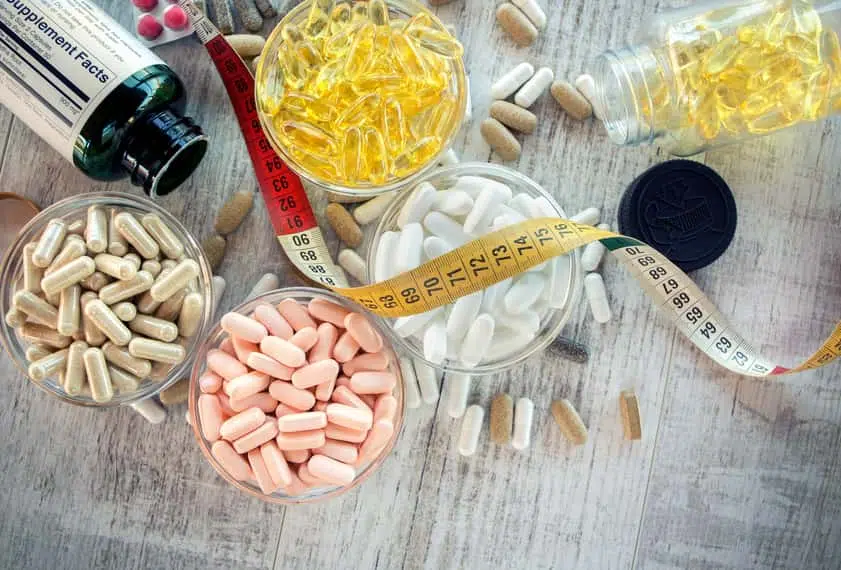Interdire le squat à un adolescent atteint de scoliose, ou l’inclure dans sa rééducation ? Selon les écoles et les praticiens, la réponse varie du tout au tout, et la littérature scientifique, loin d’apporter un verdict clair, maintient le débat. Orthopédistes et kinésithérapeutes s’opposent parfois sur les mêmes cas, chacun avançant ses arguments et ses doutes.
Les publications récentes soulignent que la position accroupie influe sur la répartition des pressions au niveau de la colonne, mais la communauté médicale n’a pas encore statué sur l’impact réel à long terme. Prudence et potentiel thérapeutique s’affrontent, laissant la question entière.
Scoliose : ce que révèle la science sur les postures et le mouvement
Quand on parle de scoliose, il ne s’agit jamais d’un simple trait sur une radio. Cette déformation de la colonne vertébrale s’exprime à travers des origines variées et des évolutions parfois imprévisibles. On distingue la scoliose idiopathique, souvent découverte à l’adolescence sans cause identifiée, des formes secondaires liées à une maladie neuromusculaire ou une anomalie osseuse, et des scolioses de novo, apparues à l’âge adulte, souvent sur fond de vieillissement discal.
Les avancées sur l’influence génétique n’ont pas encore permis de prédire la trajectoire de chaque patient. Ce que l’on mesure, c’est le degré de courbure, l’angle de Cobb, qui, s’il franchit les 10 degrés, établit le diagnostic. Les manifestations cliniques sont variables : douleurs, perte de symétrie du tronc, difficultés fonctionnelles. Pourtant, beaucoup vivent avec une scoliose silencieuse, parfois découverte par hasard. Seule l’imagerie médicale, alliée à l’examen clinique, permet d’objectiver la situation.
Sur l’impact des postures et des gestes du quotidien, la recherche reste prudente. Une certitude émerge : la sédentarité, l’immobilité prolongée, nuisent à la colonne. Mais la répétition d’un mouvement comme le squat ? Les opinions divergent, les études manquent de recul, et les recommandations oscillent d’un expert à l’autre. Ce sujet reste ouvert, la communauté scientifique réclamant des suivis de longue durée et des analyses approfondies, sans a priori.
Squatter avec une scoliose : quels risques, quels bénéfices ?
Le squat, figure phare des salles de sport, s’invite aussi dans les discussions médicales. Peut-on le recommander à une personne atteinte de scoliose ? Le mouvement engage toute la chaîne musculaire postérieure, mobilise les muscles du dos, des cuisses et des fessiers. Chez les personnes concernées par une scoliose, l’exécution du squat n’est pas toujours symétrique : le déséquilibre s’accentue, la charge se distribue inégalement. Cela peut amener à solliciter davantage un côté du corps, à compenser de l’autre, avec à la clé, douleurs ou accentuation de la déformation.
Pourtant, l’activité physique reste incontournable pour contrer la sédentarité, connue pour aggraver les troubles du dos. Les données disponibles ne montrent pas que le squat, réalisé avec une charge adaptée et dans le respect de la mobilité individuelle, aggraverait systématiquement la scoliose. Certains professionnels, loin des interdits, encouragent même la pratique du squat adapté pour renforcer les muscles profonds et stabiliser la colonne.
Voici les principaux bénéfices et risques du squat chez la personne scoliotique :
- Bénéfices : développement de la force musculaire, stimulation de la proprioception, maintien de la mobilité articulaire.
- Risques : aggravation d’un déséquilibre existant, survenue de lombalgies ou de dorsalgies, fatigue excessive si l’exercice est mal exécuté.
Le squat n’est pas universellement bon ou mauvais. Son impact dépend du degré de la scoliose, des antécédents, de la rigueur technique. Il faut rester attentif, surtout si la courbure est prononcée ou symptomatique. L’accompagnement par un kinésithérapeute ou un coach ayant l’habitude de la scoliose permet d’éviter les écueils et d’ajuster le mouvement à chaque profil.
Ce que disent les professionnels de santé : avis d’orthopédistes et kinésithérapeutes
Dans les cabinets, les questions affluent. Les réponses, elles, refusent la facilité des interdits absolus. Pour les professionnels de santé, la prise en charge de la scoliose s’appuie sur la nuance, l’adaptation constante.
Traitements, rééducation, port de corset, parfois chirurgie : le choix dépend de la sévérité de la déformation et de la gêne ressentie. Le squat, très pratiqué dans le sport, n’est pas banni d’office.
La kinésithérapie, pierre angulaire du traitement non chirurgical, mise sur l’individualisation des exercices. « L’essentiel, c’est de tenir compte de l’angle de courbure, de la stabilité du tronc et du contrôle moteur », explique un kinésithérapeute spécialisé. Le mot d’ordre ? Adapter, corriger, ajuster. La qualité du geste prévaut sur la quantité de charge.
Deux grandes situations guident l’attitude des professionnels :
- Pour une scoliose légère, l’exercice encadré permet de renforcer la musculature profonde sans accentuer la courbure.
- En cas de scoliose marquée, le squat « classique » cède souvent la place à des variantes qui privilégient l’équilibre et le contrôle postural.
Les orthopédistes rappellent que la douleur ne doit jamais être ignorée. Si l’exercice provoque des symptômes, il faut revoir la technique ou l’adapter. L’avis du professionnel guide l’intégration du squat dans la rééducation ou l’activité physique. L’accompagnement, la surveillance et l’ajustement régulier sont les clés d’une prise en charge pertinente.
Conseils pratiques pour intégrer ou adapter le squat en cas de scoliose
Pour qu’une personne scoliotique puisse intégrer le squat à son entraînement, la prudence s’impose dès les premières répétitions. Le contrôle postural devient central. On privilégie une exécution lente, réfléchie, idéalement supervisée pour corriger les écarts et garantir l’alignement.
Voici quelques mesures concrètes pour pratiquer le squat en toute sécurité :
- Échauffez-vous spécifiquement : mobilisez le bassin, assouplissez la colonne, activez la sangle abdominale profonde. Cette préparation réduit les contraintes sur la colonne déformée.
- Ajustez le mouvement : diminuez l’amplitude si une gêne survient, limitez la charge, privilégiez le squat au poids du corps ou avec des haltères légers. Des variantes comme le goblet squat ou le split squat sont souvent recommandées par les kinésithérapeutes, car elles améliorent la stabilité et limitent les déséquilibres.
- Restez attentif aux signaux du corps : toute douleur, crispation inhabituelle ou irradiation vers le dos doit interrompre la séance. La douleur est un indicateur à prendre au sérieux.
La progression se construit au cas par cas. Se comparer à des pratiquants sans scoliose n’a aucun sens. Le kinésithérapeute adapte les exercices, corrige la posture, ajuste les charges. Certains sportifs enrichissent leur programme avec des exercices complémentaires : proprioception, gainage, mobilité thoracique, pour renforcer la stabilité du corps sans aggraver la rotation vertébrale.
Bien encadré, le squat trouve sa place parmi les exercices adaptés à la scoliose. Les précautions ne brident pas l’évolution : elles construisent une marge de sécurité, protègent la colonne et préservent le plaisir du mouvement. L’équilibre n’est jamais figé, il se cultive à chaque séance, sous l’œil attentif des professionnels et à l’écoute de soi-même.