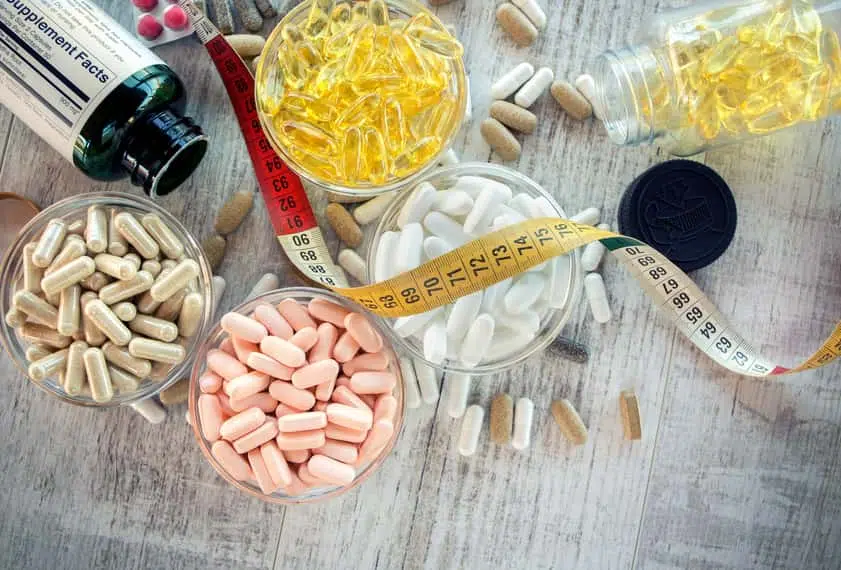La Fédération Internationale de Tennis n’impose aucun antivibrateur sur les raquettes lors des tournois officiels. Certains joueurs du top 100 ATP n’en utilisent jamais, tandis que d’autres le changent à chaque set pour des raisons personnelles. Les fabricants n’intègrent pas systématiquement ce petit accessoire dans leurs packs, malgré sa popularité chez les amateurs.
Le placement de l’antivibrateur reste libre, à condition qu’il se situe en dehors du plan de frappe. Les avis divergent parmi les professionnels, entre habitudes héritées des premiers entraînements et choix dictés par le ressenti face aux vibrations.
À quoi sert vraiment un antivibrateur sur une raquette de tennis ?
Jamais un accessoire aussi discret n’aura cristallisé tant de discussions feutrées qu’un antivibrateur. Ce discret morceau de silicone, niché entre les cordes, vise un objectif précis : atténuer les vibrations générées à l’impact entre la balle et la raquette de tennis. À chaque frappe, des ondes remontent du cadre vers la main, traversant le cordage. L’antivibrateur réduit ces secousses et modifie la sensation sans bouleverser la dynamique du jeu.Le mot qui surgit immédiatement, c’est confort. Pour de nombreux joueurs, il agit comme un bouclier, rendant le choc de l’impact balle-raquette moins abrupt. L’effet reste personnel, mais certains jurent ressentir un toucher plus doux, surtout avec des raquettes raides ou très tendues. La modification du bruit métallique, ce « cling » si caractéristique, influence aussi le ressenti. Ce détail, loin d’être secondaire, peut suffire à renforcer la confiance d’un joueur.Concernant la prévention des blessures, le sujet divise. Contrairement à une idée reçue, l’antivibrateur n’a pas d’effet direct sur les tendons du bras et n’empêche pas l’apparition du tennis elbow. Son rôle se limite principalement aux vibrations de surface transmises par le cordage, sans agir sur ce qui touche les articulations en profondeur. Les professionnels de santé sont clairs : il s’agit davantage d’une affaire de confort que de véritable protection.Pour clarifier les usages, voici les bénéfices les plus souvent cités :
- Réduction des vibrations cordes : sensation plus douce immédiate
- Modification du son à l’impact : bruit métallique atténué
- Confort subjectif accru : impression d’une frappe plus arrondie
- Pas d’effet démontré sur la prévention des blessures : la prudence reste de mise
Le choix d’utiliser, ou non, un antivibrateur dépend donc de la recherche de confort, de l’habitude et du désir de personnaliser ses sensations sur le court.
Avantages et limites : ce que change l’antivibrateur pour votre jeu
Impossible d’ignorer le clivage qu’il provoque : l’antivibrateur intrigue, suscite la curiosité, voire la passion. Son principal intérêt : adoucir l’impact. En absorbant une partie des vibrations issues de la collision entre balle et cordes, il procure une sensation plus feutrée, moins sèche. Les joueurs qui souhaitent un toucher plus doux, ou qui redoutent le fameux bruit métallique, y trouvent un allié. Que l’on joue chaque dimanche sur la terre battue municipale ou que l’on foule les allées de Roland-Garros, ce détail peut faire la différence.
Mais, qu’on ne s’y trompe pas : l’effet sur la performance reste marginal. Ni contrôle ni précision ne sont modifiés, la puissance dépend avant tout de la technique et du cordage, pas de la présence d’un antivibrateur. Les études à propos de la prévention des blessures, notamment le tennis elbow, restent prudentes : le principal bénéfice se situe du côté du ressenti immédiat et du confort auditif, sans réel impact sur la fatigue musculaire ou la santé des tendons du bras.
- Avantages : les vibrations sont atténuées, le confort s’améliore, le bruit devient plus discret.
- Limites : aucun effet sur la durabilité du matériel, pas de changement pour la puissance ou le contrôle, pas de protection supplémentaire contre les blessures.
Chez les professionnels, ce choix relève parfois du rituel, du ressenti personnel, voire d’une superstition bien ancrée. Certains y tiennent comme à leur survêtement fétiche ; d’autres s’en passent volontiers. Côté amateurs et intermédiaires, la variété des modèles sur le marché permet d’ajuster les sensations à son propre style, mais le bénéfice ne reste qu’une question de perception. L’antivibrateur ne bouleverse pas l’équilibre d’une raquette, n’influence pas le ratio de points gagnants, mais il s’invite dans la conversation intime entre le joueur et son matériel.
Positionnement sur la raquette : où et comment l’installer pour un effet optimal
Le placement de l’antivibrateur détermine en partie son influence sur les vibrations et la sensation lors de l’impact balle raquette. Sur une raquette de tennis, il doit se loger au bas du tamis, juste au-dessus du cadre raquette, coincé entre deux cordes verticales et parfois en contact avec une ou plusieurs traverses horizontales. Les règles sont claires : il ne doit jamais dépasser la première corde horizontale afin de ne pas perturber le comportement du cordage.
L’installation se fait en quelques secondes : on glisse l’accessoire, qu’il s’agisse d’un modèle « bouton » en silicone ou d’une version allongée dite ver (« worm »), entre les cordes raquette. Le bouton absorbe surtout les vibrations au centre, alors que le worm s’étire sur plusieurs cordes, pour une sensation répartie sur l’ensemble du plan de cordage. Le choix dépendra du ressenti recherché et du niveau d’amortissement souhaité.
Le poids de l’antivibrateur est insignifiant sur l’équilibre global de la raquette, mais pour certains puristes, chaque détail compte. D’autres se tournent vers les shockouts, de petits cylindres insérés dans le cordage pour cibler l’absorption. Il faut néanmoins veiller à respecter les règles : placer l’accessoire au-dessus de la première traverse expose à des sanctions lors de compétitions officielles.
- Pensez à toujours installer l’antivibrateur sous la première corde horizontale.
- Adaptez la forme (bouton, worm, shockouts) selon le degré de confort recherché.
- Après chaque changement de cordage, vérifiez que l’accessoire est bien fixé et en bon état.
Les pros en débattent : tendances et ressentis chez les joueurs professionnels
Sur les courts du circuit, l’antivibrateur est loin de faire l’unanimité. Certains, comme Nick Kyrgios, préfèrent le ressenti brut de la raquette, refusant tout accessoire qui viendrait filtrer la sensation. À l’opposé, Andre Agassi ou Andy Roddick ont vite adopté l’antivibrateur, à la recherche d’un jeu moins sec et d’une sollicitation moindre pour leurs tendons. Les mentalités varient, les rituels se transmettent, chacun écrit sa propre partition.
Le débat ne se limite pas au confort de frappe. La suppression du fameux « ping » à l’impact change la perception du jeu pour beaucoup. Certains estiment que sans antivibrateur, ils retrouvent des repères sonores plus francs, accentuant leur contrôle sur la balle. D’autres apprécient le silence et la douceur au bout du bras. Ce choix se construit au fil des entraînements, en fonction du style, des antécédents médicaux ou de la crainte du tennis elbow. Parfois, la superstition vient sceller la décision.
La réglementation ITF autorise l’antivibrateur, sans l’imposer. Les fabricants laissent la liberté à chacun de choisir, proposant des raquettes dotées de technologies intégrées (Cortex System, fibres de basalte…) ou des modèles plus classiques. Certains pros optent pour une solution minimaliste : un simple élastique noué sur les cordes, symbole d’une recherche de pureté dans les sensations. En France, les jeunes joueurs testent, hésitent, font évoluer leurs habitudes. Sur chaque raquette, derrière chaque accessoire, se joue une histoire de sensations et d’identité. Le court devient alors le théâtre de cette quête d’équilibre entre contrôle et authenticité.